[Texte de référence] Le réalisme d’Action Française par Maurice Pujo
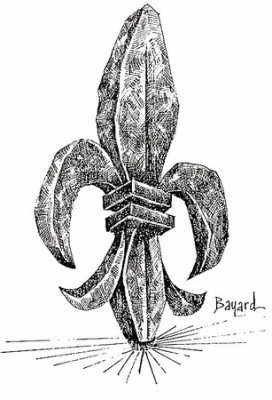 Voici un texte particulièrement intéressant de Maurice Pujo sur le réalisme de l’Action Française, où l’on découvrira par exemple le cheminement intellectuel de penseurs comme Henri Vaugeois qui, au contact de Charles Maurras, optèrent pour le royalisme…
Voici un texte particulièrement intéressant de Maurice Pujo sur le réalisme de l’Action Française, où l’on découvrira par exemple le cheminement intellectuel de penseurs comme Henri Vaugeois qui, au contact de Charles Maurras, optèrent pour le royalisme…
Je suis un témoin des origines de l’Action française. J’ai pris part à l’expérience de la première génération enseignée par Charles Maurras. Je sais quel a été le point de départ de cette génération, l’état d’où cet enseignement l’a tirée. Aux années lointaines 1892-1895, j’étais sur les bancs de la Sorbonne. Je préparais ma licence de philosophie. A la conférence de Gabriel Séailles, chacun d’entre nous avait choisi un système, métaphysique, esthétique, politique ou social. Un système, c’était alors une abstraction choisie parmi d’autres pour sa « beauté » propre et développée en droite ligne, étendue sur la création comme une belle housse qui nous empêchait de la voir. Chacun développait son système à côté de celui des autres : ils ne se rejoignaient ni ne se comprenaient dans la discussion, chacun attendant seulement, pour poursuivre son raisonnement, que le voisin eût fini de parler. Cela formait une belle Tour de Babel.
Les derniers venus, les meilleurs en avaient conçu un grand mépris de l’intelligence, fille publique qui se prêtait à tout, qui menait à la carrière politique, à la littérature, au journalisme, mais certes pas à la vérité.
L’anti-intellectualisme, la négation de toute valeur objective de la pensée fut notre dernière position. C’était le moment où Bergson soutenait sa thèse fameuse, où Paul Desjardins instaurait, en France, avec l’Union pour l’Action morale, l’école de l’impératif catégorique. C’était le moment ou nous proclamions l’antinomie de la pensée et de l’action .Pour ce triste temps, une position négative, Une position défensive, était encore la plus honnête. De fait, l’anti –intellectualisme favorisa notre réaction juste dans l’affaire Dreyfus. Il nous fit préférer le fait de la patrie, si confuse, si purement instinctive et sentimentale, aux topos des intellectuels dreyfusards qui se décoraient du nom d’idées.
En 1899, au moment où nous rencontrâmes Maurras, ce fut notre premier malentendu avec lui. Nous avions peur de l’intelligence, nous n’avions aucune confiance en elle ; lui, au contraire, ne comptait que sur elle. Il nous disait seulement que notre ennemie était la pensée fausse, qu’il s’agissait seulement de cesser de diriger notre esprit vers les nuées, et de l’appliquer au réel pour que la pensée devint féconde.
Quand je dis que cette réaction contre l’intelligence était notre état d’esprit, je parle pour la majeure partie de ma génération intellectuelle. Il y avait pourtant quelqu’un parmi nous qui, avant même de rencontrer Maurras avait toujours eu la foi aux idées, celles-ci fussent-elles fausses, qui n’avait jamais perdu cette croyance dans la valeur de l’esprit humain et qui vraiment serait mort de ne plus y croire. C’était mon cher compagnon Henri Vaugeois.
Vaugeois, plus ancien que moi de quelques années, avait, passé par les mêmes expériences et en avait même connu quelques autres. Il avait débuté comme nous par le bain de Taine et de Renan. Après avoir, comme candidat, un peu fantaisiste, à l’agrégation, connu tous les philosophes, après s’être enthousiasmé tour à tour pour Descartes et pour Kant, après avoir été tenté par Karl Marx et s’être intéressé à Bergson, il n’était pas devenu sceptique ni relativiste. Allant d’une idée à l’autre, il continuait à chercher, avec une passion jamais lasse, l’idée vraie qui le fixerait. Il n’a jamais douté de son existence : il savait qu’il la trouverait.
Au milieu du grand bouleversement intellectuel de l’affaire Dreyfus, combien de fois m’a-t-il fait trembler à cause de la fragilité des arguments idéologiques sur lesquels il appuyait un patriotisme qui, pour tant né pouvait avoir de fondement sûr que dans l’instinct et le sentiment. Son patriotisme à lui était le patriotisme jacobin : c’était une conception intellectuelle, mais qu’il poursuivait avec toute sa rigueur logique. Dans le nominalisme général, Vaugeois, avec sa foi impénitente aux idées, était ce que les Scolastiques ont appelé un « réaliste ».
Car cette vieille querelle des universaux dont ont retenti les bancs de l’ancienne Sorbonne n’est jamais éteinte. Et c’est dans tous les événements du jour, dans la vie et dans la pensée contemporaine que je prétends saisir cet éternel débat. Il s’agit de savoir si nos idées, le fruit del’élaboration de l’expérience par l’esprit, ont une valeur réelle permettant de déterminer chez nous la conviction et l’action, ou bien si ce sont seulement dés mots, des flalus vocis représentant nos points de vue individuels dont aucun ne peut réclamer, si ce n’est à titre précaire et relatif le privilège de la vérité, et qui doivent donc bénéficier de l’égalité de droits, ce que traduit, en politique, le suffrage universel.
Il s’agit de savoir s’il y a un vrai et un faux en soi, s’il y a des faits et des principes vrais qui doivent être seuls considérés et admis, fussent-ils pensés par quelques esprits seulement et même par un seul, et des faits et des principes faux qui doivent être rejetés et méprisés, auraient-ils pour eux les plus hautes autorités et l’assentiment du nombre. Aux grandes époques de l’histoire, aux époques de santé, une pareille question était résolue d’avance. Personne ne contestait la valeur de l’intelligence et la primauté de la vérité, Il a fallu la longue décomposition de l’esprit depuis Rousseau et la seconde partie du XVIII°siècle pour faire oublier, puis pour faire abolir la distinction absolue du vrai et du faux.
Maurras mit Vaugeois sur le chemin d’une vérité, la vérité politique. Je dis une vérité, et elle.-la seule, car, pour les autres, Maurras ne prétendait pas les posséder. Les autres vérités, ces vérités d’ordre moral et religieux dont son grand coeur avait toujours eu besoin, Vaugeois, poursuivant sa route, devait les rencontrer à son heure. Elles ne s’opposaient pas à celles, plus modestes, qu’il avait déjà atteintes : elles devaient les couronner.
Or, pour lui faire atteindre la vérité politique, Maurras avait simplement indiqué à l’esprit ardent de Vaugeois la seule matière digne de lui : le réel, le réel pur, débarrassé de tous les préjugés, de toutes les nuées de l’idéologie et du sentiment qui le lui avaient masqué jusqu’alors. Il l’invita à appliquer cette intelligence qui ne s’était jamais découragée, cette flamme de la pensée qu’il avait gardée si pure et si vivante à ce domaine déterminé : les conditions pratiques de la prospérité et du salut de la Patrie. Là on ne bâtissait pas en l’air, ni sur le sable; là on trouvait un terrain sûr, là on avançait. Là les lois se dégageaient des faits avec une évidence à laquelle on ne pouvait se soustraire et qui demeurait acquise. C’était l’empirisme organisateur.
Vaugeois, jusqu’alors, n’avait jamais pu résoudre le problème de l’individu et de l’Etat. Il avait longtemps erré de l’un à l’autre, tantôt liant l’Etat aux droits de l’individu souverain, tantôt absorbant l’individu dans l’Etat, aboutissant dans les d’eux cas à la même tyrannie mécanique. Le jour où sa pensée ne s’appliqua plus à un Etat et à un individu abstraits qui n’étaient, en fait, que des mots, le jour où elle s’appliqua aux choses elles-mêmes, Vaugeois aperçut toute la chaîne des réalités vivantes et distinctes qui reliaient les deux termes : la famille, le métier, la commune, la province. Il saisit leurs fonctions différentes répondant à des compétences différentes. Il saisit leur hiérarchie, fondée non sur un ordre abstrait ou esthétique, mais sur l’utilité, sur la nécessité. Et les deux termes eux-mêmes, les deux extrémités, reprirent une substance : l’individu, c’était le Français concret tel que l’a fait l’histoire; l’Etat c’était le Roi dont la race est toujours là. Vaugeois ne pleura plus la Liberté, avec un grand L, lorsqu’il conçut les libertés au pluriel. Il cessa de redouter l’Autorité lorsqu’il comprit qu’elle n’absorbait pas tout mais avait sa tâche spéciale -parmi les autres ; il cessa de craindre- pour elle la fragilité et la précarité lorsqu’il la vit appuyée sur l’hérédité.
C’est de la méthode de Charles Maurras et de la foi d’Henri Vaugeois qu’est née l’oeuvre réaliste de l’Action française. Les hommes de ma génération, ceux dont j’étais, du moins, doivent à Maurras plus encore qu’une doctrine politique. Ils lui doivent, oui, quelque chose de moral, quelque chose de très profond sans quoi toute leur existence aurait été sans armature, et serait restée inféconde ; ils lui doivent d’avoir recouvré ce que Vaugeois, lui, n’avait jamais perdu : la foi aux idées, à la valeur de l’intelligence appliquée à son juste objet, la confiance dans la raison. .
Autour de notre pensée réaliste, le nominalisme était partout. Il était, bien entendu, dans les conceptions républicaines et révolutionnaires issues des abstractions de J-J. Rousseau. Il était dans une littérature qui pouvait bien se dire elle aussi réaliste, mais qui ne l’était guère car elle ne voyait dans le réel que la matière superficielle, amorphe, non élaborée par l’esprit, ou bien se perdait dans les déliquescences du sentiment individuel devenues presque incommunicables. Mais le nominalisme était aussi chez les conservateurs qui avaient cependant la garde du riche dépôt de nogstraditions. C’était un nominaliste qui s’ignorait, mon vieil ami le baron Pie, lorsqu’il nous disait :
« Oui, la doctrine politique de l’Action française est parfaite : tout cela se tient très bien- et répond à tout, mais c’est irréalisable ; tout’ cela est excellent en théorie mais la pratique est autre chose : préparons les bonnes élections !»
De ce nominalisme-là nous ayons vu une dernière incarnation, il y a trois ans, chez ces gens qui disaient à leur tour : « L’Action française a fini son rôle ; elle a peut-être raison, mais il ne s’agit pas d’avoir raison, il s’agit de réussir. Si nous attendions que l’A. F. ait réussi, nous attendrions ‘peut-être trop longtemps. Prenons le chemin de traverse : suivons un dictateur. L’important c’est de partir: nous verrons bien où nous arriverons. A ce moment-là il sera temps d’avoir une doctrine et un programme. » Nous avons vu où -cela les a menés. Au commandement : « En avant, marche ! » tous, dictateur en tête, ont fait obstinément du « sur place » jusqu’au moment où, fatigués par cet exercice, ils se sont retrouvés par terre, assis sur leur séant.
Voilà le sort de ceux qui veulent se passer des idées, ceux, que nous avons appelés les défaitistes de la raison et dont nous avons dit qu’ils ne croyaient pas à la -présence réelle de la vie dans la pensée. On n’avance que par les idées. Seules les idées sont principe d’action. On en a eu le témoignage dès les années 1908-1909 au quartier Latin. Jusqu’alors -les Français avaient subi toutes les avanies du régime maçonnique républicain, ils protestaient par de beaux discours, ils démontraient clair comme le jour que leur droit avait été violé, et, ayant fait cette démonstration dont l’adversaire se fichait pas mal, ils étaient satisfaite et même se sentiraient fiers d’être des victimes. Mais du jour où apparurent les premières générations de jeunes gens nourries des idées de -l’A. F, ce fut autre chose. Ils n’étaient pas des sceptiques ceux-là, des dilettantes comme on disait autrefois : ils possédaient une vérité ; cette vérité avait un droit, non pas un droit verbal, un droit nominal, mais un droit vivant qui exigeait sa satisfaction. Ils commencèrent à le montrer pour la défense de Jeanne d’Arc. Pour des idées confuses, pour des nuées, pour des mots, on ne risque rien. Pour une idée vraie, pour une pensée issue du réel on affronte facilement les coups et la prison. C’est que cette pensée fait corps avec vous-même ; c’est que l’esprit entraîne, par une force qui n’est pas différente de celle de la logique, le coeur et les muscles, les bras et les poings. — et parfois même les cannes.
La vigueur qu’elle a trouvée aussitôt à son service, les sacrifices sans nombre qu’elle a suscités, et mille autres vertus pratiques telles que l’ingéniosité, la prudence, la persévérance surtout, voilà, dis-je, un bon témoignage pour la pensée réaliste de l’Action française, de même que la faiblesse de ses rivaux et de ses adversaires, leur impuissance à créer des troupes énergiques et fidèles comme les nôtres et -à obtenir autre chose que de vains noms d’adhérants alignés sur des listes, accuse leur nominalisme. Ce témoignage-là les Ligueurs d’A. F. et les Camelots du Roi l’ont donné, plus criant encore, air cours de la guerre, par le chiffre éloquent, hélas ! de leurs morts et de leurs blessés. Ils devaient se battre et tomber plus généreusement, ceux qui avaient devant les -yeux une image rajeunie et revivifiée de la Patrie.
Mais c’est un témoignage aussi de la crainte et la haine inspirées par l’Action française. Les beaux systèmes politiques et sociaux qui n’assemblent que des nuées, on ne les craint guère : on sait qu’en s’adressant aux hommes qui les .portent, devant eux, on arrivera à les corrompre ou à les tourner. Ce qui fait peur, dans l’Action française, ce n’est pas autre chose que la vérité. C’est la réalité profonde qui est en elle et contre laquelle on ne peut rien. Alors ceux qui vivent de l’illusion et du mensonge n’ont plus d’autre ressource que de tuer ceux qui menacent l’édifice des chimères. Alors, à cette Action française qui, extérieurement, ne compte que comme un groupe d’opposition parmi d’autres, on fait un honneur réservé jusqu’alors aux chefs d’Etat, l’honneur de l’assassinat. Mais le sang de Plateau, de Berger et de Philippe crie que nous sommes la vraie force, la force qui finira par l’emporter, la force de la raison.
Depuis deux ans passés, une nouvelle vague d’assaut est lancée contre l’Action française dans l’intention de l’anéantir. Elle est venue de Rome. Me sera-t-il permis d’essayer d’en dégager rapidement les traits du pur point de vue philosophique où je me suis placé jusqu’à présent ?
En 1906, tous, à l’A. F., croyants et incroyants, nous avons salué avec joie l’apparition de l’Encyclique Pascendi du saint Pape Pie X. Contre le modernisme, l’immanentisme, le relativisme, contre toutes les forces du subjectivisme à la mode, l’Eglise opérait un formidable redressement. Contre ce nominalisme universel, contre la séquelle de Kant, de Renan ou de Bergson. Elle reprenait la grande tradition de saint Thomas ; Elle proclamait la réalité de l’objet de la pensée, la valeur des universaux. Dans un monde où l’esprit découragé se décomposait, Elle se mettait magnifiquement, comme au moyen âge, à la tête de l’intelligence. Que l’intelligence pût s’accorder avec la foi, elle le prouvait assez par cette discussion puissante, serrée, qui ne craignait, rien, qui ne laissait rien dans l’ombre, qui poursuivait l’adversaire jusque dans ses dernières retraites, par toutes les pages de cette Encyclique Pascendi, qui est certainement le plus grandiose monument de dialectique qu’on ait vu depuis longtemps. La Revue d’Action ‘française la publia sous ce titre : La défense de la Raison.
Vingt ans après, en 1926, l’Action française est condamnée. Elle est condamnée non comme l’avait été le Sillon, au bout d’un très long document lourd de textes et d’arguments, mais sur les étranges motifs énumérés dans la lettre de Bordeaux. Aucun acte officiel — ils sont tous très brefs sur les motifs — aucun commentaire -des exégètes bénévoles n’en a, depuis, renouvelé les formules. Rien n’avait été fait pour établir l’exactitude de ces motifs ; rien n’a détruit, ni même tenté de détruire notre démonstration de leur inexactitude. Mais on est arrivé à nous dire : « Les motifs n’ont pas d’importance. Les décisions valent indépendamment des raisons qui les appuient. »
Dans toutes nos discussions avec les journaux dits religieux, à l’exposé de nos vérités de fait et de nos évidences, nous nous sommes vu opposer l’argument d’autorité. On nous a dit :
« Le Pape a déclaré que les choses étaient ainsi : vous ne pouvez, comme des protestants, opposer votre sens propre à celui du Pape : donc soumettez-vous. »
Nous répondons : pardon ! Il ne s’agit pas de notre sens propre ni de celui du Pape ; il ne s’agit pas de choisir entre des personnes : un tel choix serait injurieux et absurde, en effet. Mais il j a quelque chose en tiers entre le Pape et nous : il y a quelque chose qui ne dépend ni de nous ni même de Lui : il y a le fait, il y a la vérité qui existe en elle-même, et personne ne peut empêcher qu’elle soit là.
Jamais nos adversaires de la presse catholique n’ont pu se placer à ce point de vue. Jamais il n’a pu entrer en eux que la vérité n’est pas attachée au sujet, mais à l’objet. Nous retrouvons là le pur nominalisme auquel sont restés fidèles ces anciens tenants du modernisme et du pragmatisme jadis condamnés par Pie X.
Il ne nous appartient pas de définir les desseins de l’Eglise. Mais il nous est impossible de ne pas voir ce qui se passe, les tendances qui se manifestent chez ces écrivains catholiques qui mènent la bataille contre nous.
Ils ont vécu dans le monde des agnostiques, mais sans bénéficier de cette distinction essentielle des domaines divers qui, fruit d’une pensée différenciée par le réel, protégera l’Action française, les catholiques contre les dangers d’une telle compagnie. Ils ont respiré par tous leurs pores l’atmosphère de cet agnosticisme. Certains même se sont placés volontairement à son point de vue dans l’ambition de la convertir plus facilement. C’est ainsi que, dans le plan naturel, ils lui ont à peu près tout accordé. Tout se passe comme s’ils lui avaient accordé que la connaissance humaine est d’ordre relatif et subjectif, que si certaines sciences positives peuvent mettre en ordre certaines classes de phénomènes et atteindre, dans leurs résultats, un certain degré de cohérence et de permanence que le langage appelle vérité, cela ne préjuge rien sur le fond des choses, car l’intelligence est incapable de mettre un lien valable entre ces sciences, entre ces soi-disant vérités.
Les catholiques dont je parle ont accepté cette destitution de l’intelligence et ce doute jeté sur toutes les réalités naturelles, parce qu’il leur a paru suffisant, pour être sauvés, de croire, à la Réalité surnaturelle. Cette Réalité-là n’a pas besoin de l’intelligence, elle est l’objet de la foi. Il leur a paru nécessaire de croire en Dieu, mais non de rechercher en eux-mêmes et dans le monde le plan divin, la marque de la raison que Dieu y a imprimée. A leur nominalisme universel, à leur scepticisme pieux se juxta- pose un fidéisme aussi sommaire que péremptoire. Nous voilà loin de saint Thomas !
Si, pour ces catholiques, il n’y a plus rien entre l’homme et Dieu, si l’homme dénué de tout, avec une intelligence sans -valeur, réduit à ses sens et à sa conscience obscure, leur paraît ainsi plus accessible à la foi , sans doute par la voie du désespoir, on comprend que les mots de vrai et de faux dans les choses humaines n’aient plus de sens pour eux, car il n’y a pas de vérités particulières ; il n’y a qu’une Vérité absolue qui est surnaturelle.
Et c’est pourquoi l’Action française les scandalise lorsqu’elle dit qu’elle a atteint la vérité politique ; elle les scandalise moins peut-être par le contenu de cette vérité, par le nationalisme intégral, par le royalisme, que par l’existence même d’une telle vérité, surtout lorsque cette vérité suscite des dévouements qui vont jusqu’au sacrifice de la vie. Ils ont besoin de la table rase où tout n’est qu’hypothèse, et sujet à perpétuelles discussions, où il n’y a pas de lois fixes, où tous les systèmes sociaux, tous les régimes politiques sont interchangeables.
Et là est le secret de leur préférence pour la mobile démocratie, S’il n’y a de vérité que dans le Surnaturel, le représentant du Surnaturel sur la terre doit posséder seul la permanence et l’autorité : la distinction du spirituel et du temporel est à effacer. Qu’il y ait des patries distinctes et organiques, qu’il y ait des souverains, rois ou empereurs, fixant les destinées de ces patries, ce sont des obstacles, des limites à cette Autorité. Dans cette conception insensée, on pense que cette Autorité établira mieux son règne universel sur une poussière d’individus toujours en mouvement.
Je crois bien que c’est ce rêve de théo-démocratie que quelques-uns ont formé et dans lequel ils essaieront vainement de compromettre l’Eglise. C’est ce rêve qu’ils tentent aujourd’hui d’imposer à notre France. Mais il a beau se prévaloir de l’appui plus ou moins conscient de certaines autorités respectables, ce rêve n’est fait que de fumée et de nuées. Il se heurtera à la Réalité universelle. Il se déchirera particulièrement à la nature de notre sol et à tout ce que quinze siècles de civilisation ont développé dans nos esprits et dans nos coeurs.

Ping : [Texte de référence] Le réalisme d’Action Française par Maurice Pujo | Site de l'Union Royaliste Bretagne Vendée Militaire